© Micheline Weinstein / 11 novembre 2015 - 4 janvier 2016
Du ou des transfert-s de l’analyste
En-tête d’un passage de « Das Unbehagen in der Kultur »,
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1930, pp. 84-85
Die
Resistenz des Agressionstriebs
La
résistance de la pulsion d’agression
Il n’est
manifestement pas facile aux humains de renoncer à satisfaire leur penchant
pour l’agression. Ils ne se sentent pas tout à fait à l’aise avec cela. L’avantage
d’un cercle culturel restreint n’est pas négligeable, en ce qu’il permet une
issue à cette pulsion sous forme d’hostilité envers ceux qu’ils perçoivent
comme des intrus. Il est toujours possible de cimenter une quantité importante
d’humains par des liens d’amour, à la seule condition qu’il reste des étrangers
à ce cercle sur qui porter l’agression. [...] J’ai donné à ce phénomène le nom
de « narcissisme des petites différences »...
Freud
Et non pas « Die Resistenz des
Todestriebs » ou « Résistance de la pulsion de mort ».
« Resistenz » peut se traduire
également par endurance, constance, vitalité...
L’itinéraire
Du plus loin que je me souvienne, il m’a sans
désemparer été intimé de me taire.
Du plus loin que je me souvienne remonte à la 2e Guerre mondiale au milieu de laquelle je suis
née.
Ah, l’indéfectible innocence ! Écoutons plutôt
Gérard Depardieu, ce passeur sans mesure, au cours d’un entretien avec Francis
Richard,
« Étymologiquement, l’innocent,
c’est celui qui ne nuit pas. »
Les hommes [et femmes] de pouvoir ? - « La seule chose
qui leur fait peur, c’est l’honnêteté. » [...] « Ils veulent que tout le
monde se conforme aux mêmes choses, ils nous balancent des règles et des lois à
n’en plus finir, comme s’ils ne comprenaient pas ou ne supportaient pas que
chacun soit différent. »
« Et ce qui m’émerveille par-dessus
tout, ce qui a toujours guidé mes pas, ce sont les autres. »
« Le vrai danger, ce n’est pas la foi, ça n’a jamais été
la foi, le vrai danger c’est quand l’homme avec toute son arrogance, sa
perversion et son ignorance se met à interpréter les textes sacrés dans le seul
but, pas forcément conscient, de se mettre à la place de Dieu. »
« Citoyen d’un monde dans lequel les gens, où qu’ils
soient, peuvent éprouver, par instants au moins, un lien avec les autres et le
cosmos, une foi en tout ce qui les entoure.
Éprouver cet état d’innocence et
de confiance. »
En 2006 encore, je m’étonnai des ukases sur le
bien, le mal, l’interdit de penser et de dire, délivrés par des responsables
politiques, auprès desquels je glissai, paisible, que Staline était mort en 1953
et le mur de Berlin tombé en 1989.
Une historienne-et-psychanalyste fameuse de la
psychanalyse m’ayant, avec son élégance coutumière et en guise de bons vœux
2015, qualifiée de “gardienne du temple” freudien, le temps me semble venu d’effectuer
une mise au point.
Hélas, j’ai bien conscience
d’être souvent revenue sur les mêmes thèmes, au long du millier de pages
écrites depuis 50 ans. Non seulement je n’ai pas l’intention de lâcher mon
fil rouge, mais j’espère aussi que, dans chaque nouveau texte, ma réflexion contribue
par un modeste écot, à témoigner de ma dette indéfectible envers la
psychanalyse. Quoiqu’il en soit, cela est de peu d’importance, là comme
ailleurs, n’étant ni lue ni écoutée par grand monde, encore moins soumise à la critique,
après avoir enfin, très tardivement, accepté de tailler court ma niaise
candeur, j’ai conclu que je travaillais pour les archives...
Voici donc quelques-unes de mes différences
avec Freud :
• Freud est un homme, je suis une femme ;
• mes identifications privées ne sont pas les siennes ;
• mes rêves ne sont pas les siens, leur
analyse en procède, mes libres associations aussi, de même celles de chaque
analysant-e et, pour l’analyste, sa pratique analytique ;
• à propos de l’analyse par Freud, toutefois prudente, dans sa Métapsychologie, du deuil d’une personne
aimée, au contraire de ce qu’il donne en exemple, “la patrie, la liberté, un idéal”, un métier, un objet, une
rencontre sans suite, une occasion ratée, etc., je pense que, s’il s’accomplit
avec le temps quand il en relève, en amour il ne se résout jamais, nous continuons
de vivre avec, intrinsèque à notre mémorial secret.
Quoique Freud, durement atteint par de successives épreuves, ait assez
tôt nuancé ses exemples. Ainsi, à la mort de sa fille Sophie en 1920, qu’il
éprouva comme “une perte narcissique irréparable”, Freud souhaita qu’“assumer
le deuil ne [vienne] sans doute qu’ensuite”. La
réponse définitive d’une résolution possible du deuil vint, implacable, après
la mort, en juin 1923, de son petit-fils Heinele,
fils de Sophie,
Le 11 avril 1929, Freud
à Binswanger, dont le fils aîné, âgé de 20 ans, vient
de mourir
Bien que nous sachions qu’à la suite d’une telle perte l’état intense
de deuil est voué à s’estomper, nous savons aussi que nous resterons
inconsolables et ne lui trouverons jamais de substitut. Peu importe ce qui
viendra combler ce vide, car même pleinement comblé, c’est toujours d’autre
chose qu’il s’agira. Et, au fond, c’est bien ainsi. C’est la seule voie qui
permette à cet amour, auquel nous ne désirons pas renoncer, de perdurer.
Sa libido, déjà érodée par le constat de la réalité du cancer, lequel
entraîna sans discontinuer des violences physiques terribles, sa capacité de transfert-s, le désertèrent, pour faire place, écrit-il, au
“secret de [son] indifférence”. Le crabe perpétrant son œuvre le rend
dépendant, tant au physique qu’au moral, mais il demeure toutefois sensible à
qui lui témoigne de l’estime, de l’admiration, de l’amour.
[Une parenthèse • Par ailleurs, sans s’attarder sur sa relative
impuissance sexuelle reconnue et maîtrisée, ses réflexions peu gracieuses sur les
femmes - la sienne n’y échappa pas - tout en restant sensible à leur apparence,
sous condition de leur intelligence, de leur renom -, sur ses transferts dont
ceux admis comme homosexuels et surmontés, les potins de basse-cour qui
parsèment certaines biographies sur Freud à propos d’une éventuelle liaison
avec sa belle-sœur Minna, témoignent du peu d’intérêt porté à la lecture
attentive de sa correspondance (Ferenczi, Eitingon, Pfister, Binswanger, plus
circonspecte avec Jones...). Peut-on imaginer, sauf à vouloir confondre la
théorie de la sexualité avec la concupiscence et se repaître de détails fantasmés
dits “croustillants”, que Minna qui, outre qu’elle ne correspondait pas
vraiment au genre de beauté préférée de Freud, aurait fait “ça” à sa sœur, laquelle
aurait été consentante, et Freud à sa femme ? De plus, cela ce serait su, dans
les hôtels au cours de voyages, dans les centres de cure médicale, etc., et n’aurait
pas manqué de filtrer.]
Revenons à la question du deuil. En 1896, la mort de son père avait
fait de Freud l’auteur du nom propre, Psychoanalyse, pour
qualifier son œuvre en devenir. Une mort contre une vie. Et, en 1913, dans Totem et tabou, il aborde le deuil en
ces termes,
À l’égard du mort lui-même, nous adoptons une façon d’être singulière
- quelque chose qui s’apparente à de l’admiration envers qui a accompli une
tâche très difficile. [... Mais...] Quand la mort a terrassé qui nous aimons, cette
attitude conventionnelle prescrite par la civilisation, occulte notre
effondrement complet.
Voyons maintenant la mélancolie. Freud en reprend la définition strictement
psychopathologique. De mon côté, ce que j’ai désigné provisoirement par Au-delà de la mélancolie, faute de lui
avoir trouvé une autre formulation, plutôt que le caractériser par un appauvrissement
du “moi” et de l’autoaccusation, je le décrirais comme une faille, une carence
biographique de “moi”, autrement dit par une carence d’identifications
infantiles chez les enfants, par exemple, de déportés revenus,
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/chantal_akerman.html
Plus grave, autant que cela soit possible, fut cette carence chez les orphelins
de déportés non revenus, dont les enfants nés pendant l’Occupation et qui, rares, ont survécu dans les vacarmes
extérieurs de toute nature, furent, suite aux dénonciations, sans cesse
planqués dans les abris, sans cesse pris en relais par de successifs
résistant-e-s bienveillant-e-s, eux-mêmes clandestins, par des institutions,
religieuses ou pas - sans cesse déplacés d’une cache à l’autre dans toute la
France, contraints, dès l’infans, au silence pour ne
pas attirer l’attention et provoquer une rafle, privés d’accès à une phase
œdipienne structurante... Il y en eut, hélas, qui furent temporairement hébergés
par des gens parfois tout simplement cupides et malveillants, comme ce fut une
fois mon cas chez des fermiers de Vendée dont il fallut m’extraire d’urgence...
Le souvenir m’en est resté d’un train à soldats, stoppé pendant des heures en
rase campagne en plein hiver... Ces orphelins-là, après-guerre, sans “moi”
constitué, côtoyaient la déréalisation des choses et des êtres, étrangers à ce
qu’ils faisaient sur terre et, beaucoup plus tard, dans la cité quand,
boursiers de l’État, ils s’efforçaient d’être et de subsister comme tout le
monde. Il ne faut donc pas s’étonner qu’ils soient demeurés inadaptables aux
collectivités, sub-autistes, intolérants aux bruits, aux
coups, à la violence sous toutes ses formes. Il y eut cependant celles et ceux
qui n’y parvinrent pas et décidèrent, toujours trop jeunes, de quitter le monde
des vivants. Selon l’usage, à l’âge adulte, quelques hommes, mais dont un ou
plusieurs parents étaient revenus des camps, ce qui les étayait d’un minimum d’identifications,
s’en sont mieux sortis que les femmes, certains sont même devenus célèbres.
C’est pourquoi, j’avais
pensé, depuis 1979 (!), que la publication sur notre site de l’expérience de
Mira Rothenberg (Vilnius, 15 juin 1922 - [émigrée à
New York en 1939] -  Californie, 16 avril 2015), analysée et
enseignée par Paul Federn aux États-Unis, auprès de
ces enfants-là, était susceptible d’intéresser les psychanalystes qui discourent
sur la déportation,
Californie, 16 avril 2015), analysée et
enseignée par Paul Federn aux États-Unis, auprès de
ces enfants-là, était susceptible d’intéresser les psychanalystes qui discourent
sur la déportation,
Audio
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/media/M_Rothenberg_enfants.html
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/media/ITVMiraRothTexteenberg.html
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/media/blueberrytraduction.html
Textes
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/livres/enfantsdeplaces.html
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/livres/mirarothenberg.html
Or, que trouve-t-on en français sur Internet, et seulement depuis 2015
en guise de témoignage d’une d’expérience clinique insufflée par ce livre sur
ce sujet particulier d’enfants de la déportation devenus autistes : rien, si ce
n’est trois comptes rendus de psychanalystes du livre de Mira, sous le titre Des enfants au regard de pierre, paru au
Seuil en 1979, retraduit par mes soins sous le titre littéral en anglais, Enfants aux yeux d’émeraude, jamais cité
par mes “chers et estimés” collègues. Rien.
Je reprends.
• Freud, selon son dire, était carnivore, moi pas ;
• je ne suis pas fétichiste, pas plus qu’intéressée
par la numérologie ;
• je ne pense pas qu’il faille “dépasser le
père” voire le tuer, ni personne d’autre d’ailleurs, cela ne se manifeste que
dans les désirs infantiles et ultérieurement dans celui des rêves. Il me semble
simplement qu’une psychanalyse personnelle et, pour l’analyste praticien, son
analyse didactique prolongée par la permanence à vie de son auto-analyse, permettent
de se libérer des identifications primaires résiduelles, dont objectif est
de s’approprier le fil rouge de son avenir, de celui de ses analysant-e-s*, et de le maintenir
;
• le souci de Freud d’expliquer une origine à
sa qualité de Juif : de mon point de vue, “ça s’est trouvé comme
ça” ;
• je n’apprécie pas les spéculations sur la personne propre, sur les
œuvres artistiques ou littéraires, qu’elles soient terrestres ou mythiques, particulièrement
quand les informations à leur sujet sont parcellaires ou dont nous ignorons les
intentions de leurs auteurs - cela, Freud le reconnaissait. Elles s’apparentent,
de mon point de vue, à de l’analyse sauvage. Tels ses écrits sur Hamlet où, selon
le vecteur de l’interprétation de Michel Bouquet dans son entretien avec
Philippe Bilger, Hamlet ouvre la tragédie en enlaçant
le fantôme de son père mort,
... sur Shakespeare* - peut-être aiguillonné par Mark Twain, l’un de ses auteurs de prédilection, cf. Shakespeare or not Shakespeare -, comte d’Oxford, Gradiva... ; Moïse, dont la recherche des origines semble
délicate en ce qu’elle peut frayer la voie à un révisionnisme romanesque, lequel
risque souvent de dériver vers le négationnisme. Freud qui écrivait, “Les mythes sont des satisfactions
symboliques dans lesquelles le regret de l’inceste s’épanche. Ils ne
constituent pas la commémoration d’un événement”, en supposant un Moïse initialement prince égyptien, homme de haute
lignée, fondateur du peuple juif, pour s’identifier ensuite à un second Moïse
juif porteur de la Loi divine, semble condenser ici une double identification,
comme gêné par la condition initiale plus que modeste de son père réel.
Toutefois, son honnêteté intellectuelle doutait de ses spéculations, ce
pourquoi Freud avait tout d’abord intitulé son Moïse, Roman [cf. sa correspondance avec Arnold Zweig] ; sur Léonard de
Vinci, dont les Carnets ne lui étaient
pas accessibles, sans quoi Freud y aurait lu la discordance qui tourmentait le
phénix autour de 1490, entre la pulsion sexuelle, qu’il nommait alors avec
aversion “désir”, et les “splendeurs de
la nature et de l’art, de notre monde intérieur, comme autour de nous, de l’univers” [Freud, « Un souvenir d’enfance dans Fiction et Vérité de Goethe », 1933].
* Cf. pour mise à jour, Peter Ackroyd, Shakespeare, la biographie, éd. Phillipe Rey, 2006
L’erreur
de ceux qui se mettent à la pratique sans posséder la science
Ceux qui s’éprennent de la pratique
sans connaître la science ressemblent à des capitaines qui, sur des bateaux
sans gouvernail ou sans boussole, ne sauraient jamais sur quoi ils mettent le
cap. Il faut toujours bâtir la pratique sur un bon fondement théorique. La
perspective est le guide et la porte et, sans elle, on ne fait rien de bon.
Léonard de Vinci • Traité de la peinture [+ ou - 1490]
• et alii... !
Je me contente toutefois de prélever ce qui m’est
essentiel dans les écrits de Freud, c’est-à-dire les concepts, les outils fondamentaux
de la psychanalyse qu’il a établis, les interprétations que je considère comme
sauvages ayant fini par répandre une utilisation arasée de la terminologie
propre à la psychanalyse, laquelle fut très tôt expurgée de son sens, trivialisée, mise la disposition du domaine public.
Grâce à son OPE sur la psychanalyse française,
Lacan, “Jack-a-dandy”, peu regardant sur la déontologie, régulateur de mode,
heureux parangon d’une classe sociale privilégiée hermétiquement fermée à toute
ingérence extérieure non conforme, quelle que soit la qualité de l’apport des
chercheurs d’où qu’ils viennent, des éducatrices et éducateurs, des
travailleurs sociaux, du personnel soignant, honnêtes et dévoués dont il n’avait
cure, à l’américaine, réussit à couvrir de son influence le monde politique,
intellectuel, médiatique, artistique, philosophique, médical...
De telle sorte qu’il initia une secte internationale
- suivie, après qu’ils eurent perdu leur chef, par des sous-sectes orphelines, psittacistes, selon Françoise Dolto, à l’instar de celles de
nombre d’imams et de gourous, imbibée d’une terminologie absconse,
obscurantiste, inspirée de l’heideggerisme, à l’opposé
du style de Freud, peuplée de thuriféraires et d’orants, à son image
auto-exonérés d’une analyse personnelle exigible avant de se mesurer à la
pratique, ainsi que de toute responsabilité déontologique (cf. correspondance
Marie Bonaparte-Rudolph Lowenstein).
Toutefois, je n’ai à aucun moment manqué de
reconnaître la valeur de sa qualité de penseur et de théoricien éminent.
Bref, plutôt que de tirer la leçon de la
pagaïe au sein de ce que Jones a intitulé le “Mouvement psychanalytique”, de sa
résistance à la psychanalyse, faite de répétitions à l’identique des rivalités intrafamiliales
en vue de s’agréger l’amour ou/et la reconnaissance du père - puisqu’il y a toujours
absence de mère -, de luttes internes de pouvoir, de course à la notoriété, d’appétit
pour l’argent, d’exacerbation aujourd’hui parvenue à son paroxysme du Moi - l’ubuesque MOÂ ? -, c’est-à dire, plutôt que de s’intéresser à l’évolution
de la psychanalyse en empruntant avec simplicité la voie de la recherche
scientifique, telle que la définit Claude Bernard,
« La théorie est
l’hypothèse vérifiée après qu’elle a été soumise au contrôle du raisonnement et
de la critique. Une théorie, pour rester bonne, doit toujours se modifier avec
le progrès de la science et demeurer constamment soumise à la vérification et
la critique des faits nouveaux qui apparaissent. Si l’on considérait une
théorie comme parfaite, et si on cessait de la vérifier par l’expérience
scientifique, elle deviendrait une doctrine. »
[…]
« Le
savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique
expérimentale. 1° Il constate un fait ; 2° à propos de ce fait, une idée
naît dans son esprit ; 3° en vue de cette idée, il raisonne, institue une
expérience, en imagine et en réalise les conditions matérielles. 4° De cette
expérience résultent de nouveaux phénomènes qu’il faut observer, et ainsi de
suite. »
[…]
« Les hypothèses
sont indispensables comme les échafaudages sont nécessaires pour
construire une maison. Sans hypothèse, c’est-à-dire sans une anticipation
de l’esprit sur les faits, il n’y a pas de science, et le jour de la dernière
hypothèse serait le dernier jour de la science. »
[…]
« L’observation
initiale doit être celle d’un “phénomène imprévu”. »
[…]
« Une théorie est un modèle
de la réalité, dérivé de principes de base. La réalité est toujours plus
complexe que la théorie, c’est pour cela que chaque théorie a un domaine où
elle s’applique. Une théorie qui n’est pas vérifiée ou vérifiable par l’expérience
n’est pas scientifique. »
on reproduisit tels quels ses agissements et,
au mieux, des théoriciens parvinrent à réduire la psychanalyse à un système
philosophique. Il m’arriva d’entendre des praticiens, sans doute pour ne perdre
ni leur temps ni le fruit de leurs honoraires, déclarer que la fonction
thérapeutique de l’analyse [sic] “ne
marchait pas”.
La psychanalyse, me semble-t-il, est un
processus dynamique en perpétuelle
évolution, ce pourquoi sa théorie ne peut être internée, tel un dogme, dans l’habitacle d’un cursus universitaire,
encore moins en terminale lycéenne, pas plus qu’au sein d’une coterie, restreinte
ou aussi internationale soit-elle.
Dans la pratique, l’analyste, qu’il soit ou
non médecin, en un premier temps, se cale sur les concepts
fondamentaux, animé du désir de fertiliser la psychanalyse, mais ne peut
le faire qu’à partir de sa singularité. Cela ne va pas, chez l’apprenti
psychanalyste à ses débuts, sans incertitudes, sans risque de paralogismes,
auxquels seule remédiera l’expérience acquise, accompagnée le temps qu’il
faudra par un-e ou plusieurs analyste-s qualifié-e-s, librement choisis, estimés, précellents et, cela va de soi, par les lectures, d’abord impérativement, ce qui se fait
rare, de celle de Freud, par la participation aux groupes de travail, éventuellement
par l’exposition écrite ou/et orale de ses hypothèses originales... - à condition
que l’“on” veuille bien le laisser s’exprimer.
Du côté de l’analyste expérimenté, l’analyse continue
de ses rêves, c’est-à-dire celle des tours que lui jouent les formations de son
inconscient, l’exercice d’approfondissement d’une meilleure connaissance des
pulsions et des transferts qui l’éperonnent, afin de s’employer à mieux les
neutraliser, non seulement permettent d’arpenter déchronologiquement la formation et l’évolution de ses symptômes, mais de modeler le style
singulier du praticien.
Bref, c’est ainsi que, survivante du monde d’avant-hier,
je fus éduquée et, le terreau biographique aidant, suis demeurée fort
an-adhérente aux camarillas.
Sans doute ma biographie s’y prêtait-elle... C’est
ainsi encore que j’appris à écouter, à me garder d’orienter l’écoute de l’autre
à partir des présupposés d’une mémoire sélective, de ses symptômes résiduels.
Cela n’exclut pas de s’instruire, de rester
attentive aux spéculations théoriques et aux différents courants du siècle.
Toutefois, dans l’exercice quotidien, mon souci fut : comment en tirer
parti sans projeter des inférences personnelles ? Sont-elles applicables,
universalisables, devant le mal-être spécifique, la biographie, la place dans
la société, d’un enfant, d’un adolescent, d’un adulte, d’un “senior”, d’un
malade, d’un mourant, des “cabossés” de la vie ?
Quant aux hypothèses théoriques successives,
qu’elles soient de Freud, des pionniers de la psychanalyse, des collègues
anciens ou actuels, à chacun-e de les étudier, de
lire et relire les textes fondamentaux d’auteurs éprouvés, aussi bien, mais
cela n’a qu’un temps, tant ils sont fastidieux et navrants, que ceux des détracteurs
de toutes disciplines, ceux des historien-ne-s, des potineurs et potineresses et, préférentiellement, des
philosophes depuis que la France a opté pour le ravalement de la psychanalyse à
une philosophie, histoire de rivaliser avec son éventuelle captation par la
psychiatrie, fussent-ils obstinément mus par une résistance opiniâtre, mère d’une
haine inextinguible. Par respect pour la haute intelligence de ces penseurs et
leurs facultés d’interprétations, j’ajouterai que cette résistance au savoir, l’a
priori de principe, sont souvent délibérés (d’où le négationnisme, etc.).
Reste que l’un de mes outils de travail privilégié
incline plutôt vers l’étude des abondantes observations cliniques.
Mon histoire de
la psychanalyse
Françoise Dolto remarquait que la plupart des livres
écrits par des historiens de la psychanalyse se résumaient à des histoires individuelles
ou groupales de transferts. J’ajouterais : des histoires de transferts orientés, lesquels servent à adorer des
idoles (idéal enflé du “Moi”), à éreinter, en termes d’une indécence
affligeante, qui ne pense pas comme soi, qui développe une pensée originale, et
parfois à afficher l’idéologie dans le vent. Ce n’est pas nouveau dans l’histoire
de la psychanalyse, ces usages sont nés avec elle.
C’est pourquoi, après avoir épuisé tant de
lectures, en ce domaine précis de la biographie de Freud, de l’histoire de l’éclosion
de la psychanalyse au XXe siècle, de son extension, de celle des
dissensions internes et externes, de l’évolution des courants de pensée, de l’approfondissement
des concepts..., je ne me fie qu’au monumental, loyal : Freud • A Life for our time (Norton, 1988), traduit par : Freud
• Une vie (Hachette, 1991), de Peter Gay. Toutes les références, notes, augmentées
de réflexions critiques et d’un essai bibliographique, nécessaires aux
investigateurs et investigatrices ou simplement aux amatrices et amateurs, s’y
trouvent.
Le ou les transfert-s de l’analyste
Le transfert de l’analyste fut longtemps
désigné par “contre-transfert”, c’est-à-dire l’incidence de ce que projette
l’analysant-e sur l’éprouvé inconscient de l’analyste. Ce fut humainement
inévitable dans les années d’élaboration de la psychanalyse, lors des errances
précédant la mise en place de ses concepts fondamentaux et de leurs
applications, cela ne l’est plus.
Depuis plus d’un siècle, le transfert de l’analyste
a-t-il, comme nous aurions pu l’espérer, été maîtrisé ? N’a-t-il pas
plutôt été asservi, remplacé par les identifications de nombres d’analystes à
leurs maîtres à penser et ainsi réduit à l’identification moïque de l’analysant-e à l’analyste et inversement de l’analyste à l’analysant-e,
lesquels fusionnent leurs histoires, leurs mythes, leurs symptômes, leur
mémoire, respectifs ?
L’interprétation analytique ne serait-elle pas
un art voisin, analogique bien que non identique, à celui auquel s’exercent les
comédien-ne-s pour réussir à incarner un personnage dont d’entrée de jeu ils se
sentent étrangers ?
Quelques exemples dans mon analyse : lors
de mon premier rendez-vous avec l’une parmi mes analystes, pourtant lacanienne
renommée - et “chère” à l’époque à tous points de vue -, je lui expose en
quelques mots le motif de ma démarche. Je m’entends répondre aussi sec :
“Je sais, je suis au courant” (elle avait sans doute au préalable appelé
Françoise Dolto, à qui j’avais demandé l’adresse). Plus tard, je l’instruis du
choix de mon contrôleur d’élection, François Perrier ; réponse : “C’est
de la caricature et de la dérision”... Je sors de cette séance et glisse sur le
trottoir : fracture du coccyx, d’où je conclus : “J’en ai plein le...
dos.”
Passons sur ce que j’ai, à chaque fois - et il
y en eut -, répliqué, j’étais très jeune, ce n’était pas vraiment gracieux...
De leur vivant, je n’ai jamais lu ni entendu,
malgré des divergences, Françoise Dolto, François Perrier, dénigrer en des
termes ouvertement blessants qui que ce soit, bien au contraire, comme le font
les partenaires parentaux pour ne pas déprécier chez les enfants la
représentation de l’autre et, dans mes lectures, pour faire bref, Anna Freud
non plus, dont je n’ai pu excuser Lacan de l’avoir, avec une rare bassesse,
injuriée publiquement, et son père à travers elle, lors d’un congrès d’analystes.
De même qu’antérieurement, je n’avais pas compris ce
qui avait dispensé Anna Freud de réagir avec fermeté auprès de Jones qui, dans
sa biographie de Freud, réglait son antipathie personnelle - sa jalousie - envers
Ferenczi au moyen de la plus transparente des diffamations. Peut-être, Anna se considérait-elle
en dette envers Jones, lequel avait contribué à l’exil de Freud et de son
proche entourage, ce qui n’est pas vraiment courageux.
Néanmoins, j’aimais bien mon analyste, le goût
que nous avions en commun pour la musique classique, elle m’évoquait le jazz,
Nina Simone, les champs de coton du sud des États-Unis, la Côte de l’or et ses
arts premiers... Estimant devoir acquitter ma dette envers la psychanalyse, je
poursuivis encore quelques années et, outre mes activités professionnelles, à
sa demande puisque sa vue déclinait, j’enregistrai pour elle sur cassettes les
fondamentaux de la psychanalyse dont : l’Analyse des rêves (Freud, Die
Traumdeutung), l’Éthique à partir
de la version originale sténotypée de Lacan et ses Écrits... j’en passe (recherches en bibliothèques, traductions...). Je n’ai
jamais ouï un simple “merci”.
Lasse d’être administrée comme un larbin, en
guise de “contre-transfert” et d’“empathie” de sa part, je suis partie vivre ma
vie et mon travail ailleurs.
C’est tout à fait par hasard que, des années
plus tard, il m’est revenu en écho par une collègue, qu’elle disait de moi qu’il
fallait prendre en compte la justesse de mes intuitions.
Et puis, en 2004, elle m’a appelée, je suis
allée lui rendre visite, c’était pour me dire “au revoir”, quelques semaines
avant sa mort.
Par contre, quand elle est définitivement
partie visiter l’autre monde, ni ses ayants droits, ni ses secrétaires, pas
plus que l’entourage que j’avais bien connu, ne m’en ont informée, je le fus personnellement
par Anne-Lise Stern.
Le temps passa. Depuis, j’ai réalisé, sans
aucun doute grâce à la formation que j’avais reçue, que ma fonction d’analyste
prenait garde d’être altérée par un calamiteux “contre-transfert” ; j’écoute... et
fais mon travail, je l’espère, au mieux de mes aptitudes...
Enseignée par Françoise Dolto et François
Perrier, parallèlement, je me suis laissée enseigner par Sandòr Ferenczi, d’où ma prise en compte de la portée et de la gravité du trauma, qu’il
soit de guerre, de toute nature, ou provoqué par les abus sexuels relatés dans
les récits quasi quotidiens et qui ne sont pas des fantasmes. Seule l’angoisse
persistante peut majorer l’agression sur le corps avec son retentissement délétère
sur la psyché. Par contre, s’il y eut effraction, viol par pénétration, de cela
la victime ne pourra en “faire son deuil”, aucune thérapeutique n’y remédiera,
nous ne pouvons que l’aider à acquérir une faculté de vivre avec sans être
détruite, à établir un équilibre permettant au mieux possible une relation à
autrui et au monde extérieur.
Mais je n’ai pas adhéré aux hypothèses de Ferenczi
sur l’“analyse mutuelle”, encore moins sur son usage, dont je pense que, de
fait, elle instrumente le transfert de l’analyste, elle déstabilise l’analysant-e,
quand bien même elle s’adresserait à qui se destine à pratiquer la
psychanalyse. Sensible à l’empathie, mais pas au pathos, j’opte plutôt pour un accueil
cordial et respecte l’écart entre le privé et le professionnel. L’expérience
fait la suite. Quant au transfert de l’analyste, s’il y a, je le garde pour moi
et continue de me fier à l’analyse du rêve.
D’une part, il est possible que ma biographie
ne se prête pas à la familiarité ; de l’autre, côté transfert de l’analyste, déjà
dès ma première séance dite de contrôle, pour éprouver les répercutions de ce
premier rendez-vous, j’ai fait part à l’analyste que j’avais choisi, François
Perrier, du dernier rêve de la nuit passée. Les associations, les lapsus, ou accès
à la liberté de développer le sens de l’humour, les formations de l’inconscient,
suivirent (... cf. supra).
J’ai été déçue, venant de Freud, de son
indélicatesse envers Ferenczi, qui fut son analysant, dans sa lettre du 13 décembre
1931, à laquelle sa femme, sa belle-fille, un ou une proche aurait pu avoir
accès, où il rappelle à Ferenczi que “ d’après [son] souvenir - la tendance aux
petits jeux sexuels avec les patientes ne vous était pas étrangère dans les
temps préanalytiques, si bien qu’on pourrait établir
un rapport entre la nouvelle technique et les errements d’autrefois.” Dans la
correspondance Freud-Jones, je n’ai lu aucune telle allusion relative aux présumés
“errements” passés de Jones. Je n’ai pas non plus souscrit au crédit que Freud
accorda aux ragots venimeux largement répandus par Jones, qui fut l’analysant
de Ferenczi, qualifiant Ferenczi de paranoïaque, donc
délirant (comme Freud en conclut de Fliess ?). Ce genre d’accusation a fait
florès depuis un siècle. Nombre d’analystes lacaniens en sont de vulgaires
héritiers. Dès que l’existence, la pensée, la parole, la personnalité, de l’une-e de leurs collègues, dont ils glanent d’ailleurs
allègrement les idées originales, les indispose, tout en pérorant par exemple à tous
vents sur la déportation..., la biographie de leurs contemporains - qui pourtant n’est
pas pour rien dans l’expérience, ne les intéresse pas -, la rumeur court
publiquement, à pleine voix, aussi bien dans les culs de basse fosse, dans les
colloques, que dans les bistrots et autres lieux où ils se réunissent, l’anathème
tombe : paranoïaque, et la pratique analytique des réprouvés [sic] “n’est pas de la psychanalyse”.
Il m’est aussi venu à l’esprit que Freud, aussi bien que Ferenczi, ne se sont peut-être pas montrés suffisamment attentifs à la nature de l’attente insatiable d’amour de Ferenczi en la privilégiant du côté du père. N’aurait-elle pas plutôt été adressée à son insu à la mère, c’est-à-dire celle qui, quoiqu’il arrive, témoigne d’un amour inconditionnel ?
Les derniers temps de Ferenczi furent
terribles. Or, nous savons que des accès délirants peuvent survenir
provisoirement après une anesthésie, par suppression de l’arrivée d’oxygène -
les multiples interventions pratiquées sur le visage de Freud s’opéraient,
autant que faire se pût, sous anesthésie locale -, ou suite à la prise à haute
dose de certains médicaments prescrits en vue d’apaiser la douleur, lesquels
sont encore aujourd’hui ceux qu’applique la psychiatrie.
Ferenczi, dépassé par sa confiance
inconditionnelle en Freud, tourmenté par son ambivalence, c’est-à-dire d’un
accès à l’indifférence, et non pas à la haine - la haine est la haine et non l’antinomie
de l’amour, en amour défunt elle n’est que mandataire -, semblerait cependant
avoir gardé une naïveté d’enfant. Peut-être n’avait-il pas réalisé que Freud, à
75 ans, était lourdement invalidé par le crabe. Sa bouche, sa porte-parole, ses
fonctions physiologiques, étaient saccagées, il était torturé, toutefois en
silence, par une douleur effroyable permanente depuis des années, par des
interventions chirurgicales et des anesthésies répétées, était devenu sourd d’une
oreille, son investissement libidinal d’objet s’était éteint, d’où son désintérêt
pour la thérapeutique, et manifestait de l’impatience, ne recevait plus d’analysant-e-s
à titre individuel, seulement encore de rares candidats à la didactique... État
qui ne justifiait pas la critique de Ferenczi sur un “excès pédagogique” de
Freud au détriment de la thérapeutique...
C’est ainsi que récemment j’ai adopté la
jolie, et seule à mon sens, maxime qui me paraît juste pour témoigner du
transfert de l’analyste, aussi bien envers ses collègues qu’envers ses
analysant-e-s, elle précède la signature d’Henriette Michaux dans sa
correspondance,
Amitié de
travail.
M. W.
4-10 janvier 2016
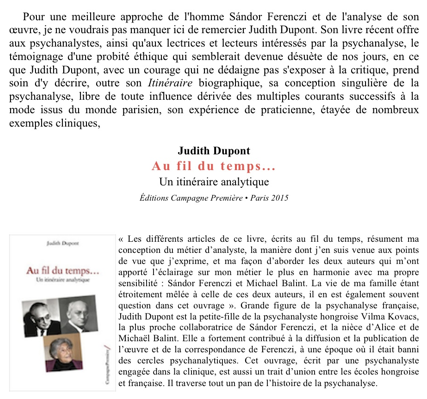
* Cette manie démagogique électorale, parmi d’autres, de féminiser la terminologie française actuelle est calamiteuse à l’écrit, ce pourquoi
je ne l’ai pas, ici, toujours respectée. Comment fait-on avec le pluriel ?
Cela a-t-il modifié d’un iota le sexisme ? Les filles, les femmes ne s’y
trompent pas, de surcroît quand elles ont été privées de références familiales
et autres supports prestigieux...
• Ajout au 1er janvier 2016. Quand cessera-t-on de se
référer aux “plus démunis”, comme si cette condition sociale relevait d’une
norme ?
• Au 3 janvier. Quelle nécessité pour le Président
français, dans son discours de bons vœux 2016, de déformer notre pensée en fustigeant
une “nostalgie”, quand nous parlons de patrimoine historique et culturel ?
• Au 10 janvier. Nouvelle édition de Mein Kampf. Je me suis procurée l’édition complète en français de Mein Kampf vers 1966, dans la librairie de Le Pen, alors basée place Saint-Sulpice. Quels intellectuel-le-s pourraient avancer que Heidegger ne l’avait pas lu, ne s’en était inspiré, n’avait pas généreusement prodigué son idéologie dans son enseignement, usé durablement de son influence, pour ensuite se tenir comme au-dessus de la mêlée, emberlificotant les discours issus de sa docte pensée philosophique ? J’en fais état en 1967 (cf. dans mes « Travaux 1967-1997 [et, en cours, jusqu’à 2016] »), ainsi que dans ceux, outre la publication de son monumental « Langages Totalitaires » en 1976, de Jean-Pierre Faye, que l’on trouvera sur notre site aux adresses suivantes :
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/livres/faye3.html [1998]
http://www.psychanalyse.et.ideologie.fr/livres/correspfaye.html [2003-2005]
En 1987, paraissait traduit en français chez Verdier, « Heidegger et le nazisme », étude dûment documentée sur de longues années du philosophe chilien Victor Farias. Quel titre chapeau avons-nous lu dans la presse de l’époque : Qui est ce Victor Farias ? Suivaient, venant de penseurs encore tendance aujourd’hui, des critiques d’un incomparable mépris, égal d’ailleurs à celui porté sur l’analyse de ce livre par Georges Ralli, publié cette même année dans nos éditions papier.