© Tania Bloom / 21 décembre 2015
Brèves de lectures récentes
et
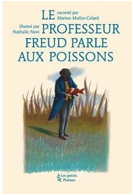
Marion Muller-Colard
Le professeur Freud parle aux poissons
Illustré par Nathalie Novi
Éditions Les
petits Platons, Paris, octobre 2015
« Tu connais ces
grenouilles ?
interroge le professeur Freud.
- C’est pareil
tous les jours, soupire la carpe.
Ça essaye de
grimper sur son nénuphar, Surmoi lui flanque une beigne,
Ça recoule et Moi
est bien embêtée. »
“Vous
nous avez enseigné à avoir le courage d’approcher de près les choses, d’approcher
sans peur et sans fausse honte même la partie la plus extrême et la plus intime
du sentiment. Et il faut du courage pour être sincère - votre œuvre en témoigne
comme peu d’autres à notre époque.”
Stefan Zweig,
Salzbourg, le
15 avril 1925
Exergue de
Marion Muller-Colard
ø
Henriette Michaud
Les revenants de la mémoire
Freud et Shakespeare
Petite bibliothèque de psychanalyse • PUF, Paris,
septembre 2011, 200 p.
Quand la lectrice, le lecteur, ouvrent l’écrin marine sur lequel l’équipe
de graphistes de l’atelier Didier Thimonier a tracé la métaphore du destin d’Œdipe,
sous la protection du vautour, l’oiseau-mère égyptien - ou est-ce Horus, le dieu faucon ? - juché sur le Sphinx, qu’y découvrent-t-ils, si ce n’est un gardénia, fleur
préférée de Freud.
Plutôt que de s’essayer à l’application souvent besogneuse de la
psychanalyse à des œuvres littéraires ou artistiques comme le firent des élèves
de Freud, parmi lesquels Otto Rank, Ernest Jones... et bien d’autres, Henriette
Michaud, dont l’érudition n’a d’égal que sa dilection pour Shakespeare, son
amour de l’étude à partir de la langue d’origine..., sa préférence pour les
traductions de l’un des poètes majeur de notre temps, Yves Bonnefoy, a choisi
de nous désaltérer à la source même, celle qui abreuva son promoteur.
Ainsi, sa réflexion et le voyage au long cours qui s’ensuivit dans l’œuvre
de Freud, l’amenèrent à nous poser la question :
« Quel
rôle Shakespeare a-t-il joué dans l’élaboration de la psychanalyse ? »
Mieux que je ne pourrais l’écrire, les lectrices et lecteurs intéressés
et plus particulièrement les psychanalystes, trouveront aisément sur Internet
les comptes rendus développés de cette pierre précieuse offerte par Henriette
Michaud à l’édifice de la psychanalyse.
Je me contenterai ici de relever ce passage sur la quatrième de
couverture :
« Arlequins
ou fantômes, vêtus de neuf ou dans leurs costumes d’origine, les mots de
Shakespeare déplacés dans la langue de Freud gardent sur eux l’éclat du voyage.
Comme si la psychanalyse à ses commencements avait besoin de ces éclats d’étranger,
de ces revenants de la mémoire. »
ø
Henriette Michaud
Freud éditeur
Les Almanachs de la psychanalyse 1925-1938
Éditions Campagne Première,
octobre 2015, 172 p.
J’intitulerais volontiers, par un deuxième sous-titre, ce travail,
composé à partir des éditions originales, attentivement commenté par Henriette
Michaud : « Une autre histoire de la psychanalyse », une vraie histoire de la
psychanalyse, et non des psychanalystes, que Françoise Dolto appelait “histoires de transferts”.
Excepté à ma connaissance limitée, le Freud de Peter Gay et La mort dans la vie de Freud de Max Schur, nous n’avons en effet jusqu’à
présent à notre disposition que l’une et l’autre histoire de la psychanalyse,
inspirées par le journalisme, dans lesquelles nous lisons ce que Lacan nommait
des “historioles” infantiles, parfois d’intentions sub-salaces, anecdotiques,
non vérifiées, narrées par des “spécialistes” non analysés ignorants délibérés
de la volumineuse correspondance de Freud avec ses élèves et/ou amis
psychanalystes, dont quelques proches au long de plus de trente ans d’échanges,
laquelle nous révèle les hypothèses, les errances, les certitudes, bref l’évolution
de la théorie en devenir. Quant à la somme en trois volumes d’Ernest Jones, si
elle nous éclaire sur « La vie et l’œuvre de Sigmund Freud », elle est à mon
sens à lire avec acuité, puisque souvent déloyale envers qui, Freud y compris,
est perçu par un auteur animé d’une jalousie irrépressible, comme un concurrent
à dénigrer, voire à abattre.
Les éditions, Internet, nous fournissent inlassablement les mêmes
clichés, les mêmes slogans, les mêmes citations, se recopient littéralement,
comme titulaires d’une vérité incessible, sans la moindre retenue.
Henriette Michaud, avec son Freud
éditeur, nous présente ce dont témoignent « Les almanachs de la
psychanalyse », commentés avec l’honnêteté intellectuelle qui lui est
propre, le travail énorme, aussi bien théorique que clinique, ses applications,
effectué par les défricheurs passionnés de ce que Freud nommait - et espérait,
hélas sans grand succès - être “La nouvelle science” dont il fut le promoteur.
Henriette Michaud nous offre ici, au-delà des dissensions, des
dissidences, des résistances, le “témoignage
exceptionnel de la présence et de la diffusion de la psychanalyse pendant une
période mouvementée”, notamment l’épisode qui fut dominé, au mépris du
désir de Freud, par l’hostilité internationale victorieuse à l’encontre de sa
pratique par les non-médecins, dépossédant la psychanalyse de sa singularité,
aujourd’hui réduite à un enseignement universitaire vidé de la psychanalyse
personnelle indispensable pour témoigner de ce dont on parle, ou permise chez
qui s’en intitule par “L’analyste [analysé ou la plupart du temps, pas] ne s’autorise
que de lui-même” de Lacan.
ø
Judith Dupont
Au fil du temps...
Un itinéraire analytique
Introduction
d’Éva Brabant
Éditions Campagne Première, septembre 2015, 370 p.
Excepté des analysant-e-s ami-e-s qui m’ont transmis lui en être encore
aujourd’hui reconnaissant-e-s, ayant suivi leur psychanalyse individuelle avec
Judith Dupont, je ne l’ai pas croisée. Cependant, j’ai lu assidûment Le Coq-Héron pendant près de quarante
ans, ainsi que son Manuel à l’usage des
enfants qui ont des parents difficiles et, pour ma pratique, étudié et pris
en compte, avec je l’espère, discernement, l’œuvre de Ferenczi (et de quelques
autres...), lequel n’a jamais cédé sur l’hideuse réalité de la maltraitance
sexuelle, dont nous entendons au quotidien et essayons de neutraliser au
maximum les dégâts encore aujourd’hui en 2015. De même, n’ont pas disparu,
quelles que soient les modes, les us et coutumes des praticiens, la désertion
de beaucoup à l’analyse de la sexualité de leurs analysant-e-s, le passage d’un
siècle à l’autre, les inventeresses perpétuellement
renouvelées de la psychanalyse, les hystériques.
Je viens de lire l’itinéraire professionnel de Judith Dupont, indissociablement
lié à sa biographie, écrit au fil du temps avec la vivacité bienfaisante d’un
dialogue ininterrompu entre ami-e-s ou/et collègues toujours attentifs à l’évolution
de la psychanalyse, comme le témoignage, peu fréquent dans la forme, d’une
clinicienne authentique dans l’histoire de la psychanalyse, attachée à ce qui
doit singulariser, selon Jean-Claude Lavie, la technique de chaque analyste,
soit :
« Il ne
faut pas confondre pratique et technique. Une pratique est un mode de gérer une
technique, particulière au style de la personne qui l’applique ou aux
nécessités d’un cas. [...] La pratique est par nature personnelle, elle ne peut
jamais consister à imiter ou à copier fût-ce un maître. C’est la personne même
de l’analyste avec tout ce qui la constitue, qui élabore la situation et qui la
régit. »
Et c’est avec une remarquable honnêteté intellectuelle que Judith
Dupont, décrit par le menu son
style singulier de pratique, émaillé d’exemples cliniques.
Je terminerai sur un aspect sensible, étonnamment moderne, de la
pratique de l’analyste, légué par Ferenczi, avec cet extrait du livre de Judith
Dupont, attentive à la transmission de la psychanalyse :
« Ferenczi
a compris que la “neutralité”, l’“indifférence”, prônées par Freud dans le but
de ne pas enfermer le patient dans une relation sans avenir avec l’analyste, n’étaient
pas valables avec tous les patients, ni à tous les stades d’une analyse. Les personnes que nous appellerions
aujourd’hui des “cas limites”, ou les patients en état de régression, avaient
besoin d’autre chose. L’idée de Ferenczi était de leur offrir, par son
comportement, l’expérience de soutien, de sollicitude, de sécurisation, qui
leur a fait défaut autrefois. Il obligeait ainsi l’analyste* à payer de sa personne, bien
au-delà de ce que la plupart de ses collègues étaient disposés à faire. »
[* Non seulement à être au préalable suffisamment
analysé]
L’“écoute indifférente” ou “neutralité bienveillante”, introuvable dans
les écrits de Freud, ici évoque ce qu’écrivait François Perrier :
« Niaiserie.
Fantasme de l’impersonnalité de l’analyste. »
Enfin, Judith Dupont dessine à l’intention de ses lectrices et lecteurs un horizon
optimiste pour la psychanalyse. Elle fait ainsi sien l’aphorisme de Lamartine :
“Je lis dans
l’avenir la raison du présent.”